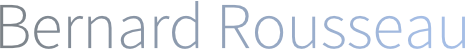Ma démarche artistique articule et met en résonance les pratiques souvent intimement liées du dessin et de la peinture, étend par des ramifications à la sculpture, la vidéo et l’installation, la volonté de questionner l’ambiguïté du regard, instaurer le trouble, créer des tensions en mettant le visible et le réel à l’épreuve.
Entre dessein et désir, cadence et rythme, endroit et envers de l’image, mon œuvre se pose comme une rencontre à la frontière des mondes.
Lire aussi :
Ici est ailleurs
Une rivière
Les œuvres exposées ici ont un rapport avec la rivière : les éléments qui la composent : l’eau, plus ou moins transparente, ses galets et ses poissons, mais aussi la rivière qui trace un chemin plus ou moins sinueux, rapide ou nonchalant.
Bernard Rousseau aime les rivières. Il en est familier. Une rivière, c’est une surface qui scintille d’éclats de soleil, qui ondoie, qui se métamorphose tout en demeurant identique à elle-même. Une rivière, ce sont des effets de lumière, c’est une expérience du temps qui passe et qui se fige, c’est une vie secrète qui se cache dans les profondeurs. C’est un ici et un ailleurs.
Certaines rivières sont paresseuses et bucoliques – rivières ensoleillées du dimanche. D’autres sont sauvages : rivières d’aventures, elles conduisent au bout du monde, ou s’enfoncent Au cœur des ténèbres.
Bernard Rousseau est patient, il est attentif. Son expérience des rivières, il la doit à la pratique de la pêche à la mouche, une technique de pêche exigeante, qui requiert de la concentration et qui exerce le regard à la surface de l’eau. La rivière reflète le ciel, les nuages, ou bien, selon un angle différent, elle laisse entreapercevoir l’ombre des poissons. La truite vient gober les insectes posés sur l’eau. De petits cercles concentriques trahissent sa présence. Elle est à la fois invisible, furtive et décelable pour un œil exercé. Il y a quelque chose de ce jeu avec la surface dans la peinture de Bernard Rousseau – quelque chose de cette application du regard, de sa densité et de sa justesse – un soin et/ou un souci qui nous sollicite et nous demande la même disponibilité.
Selon quel angle allons-nous regarder ?
Notre regard plongera-t-il dans la peinture ? Passera-t-il au travers de ces reflets qui recouvrent les ombres – en profondeur ?
La facture de l’art
Considérons l’intitulé d’une des œuvres exposées : Sous les galets, épaisseur bourbeuse, voir, 200 x 140 cm , 2016, Fusain sur papier de soie résiné avec couverture de survie en fond.
Comment faire pour rendre “l’épaisseur bourbeuse” à travers laquelle on voit et on ne voit pas ? Comment faire pour rendre le trouble, la perception du trouble ? Comment rendre cette expérience-là sensible ? Il faut dire ici un mot du travail de la peinture – de l’art proprement dit.
Depuis plus de dix ans, Bernard Rousseau expérimente des techniques, des procédés et des matériaux originaux. Il a mis au point un processus de création qui lui est propre. Son travail se déroule par étapes : d’abord il effectue des captures photographiques, à partir desquelles il réalise des dessins et des impressions sur cire. Ensuite, il procède au travail de peinture, sur plusieurs couches et à des encollages… L’élaboration est méthodique, ingénieuse. L’œuvre se développe à son rythme, étape par étape – à force de superpositions, de strates, de juxtapositions. Par un travail qui s’apparente un peu à l’action d’une rivière, il finit par obtenir comme une sédimentation de regards.
Sans entrer davantage dans le détail, il est certain que ces peintures ont une qualité sensible particulière – une qualité inhérente à ce processus : une facture soigneusement étudiée, travaillée, mais sans aucune sophistication inutile.
D’où, ce qui est à mon avis décisif : l’impression d’achèvement.
Je crois sentir cette cohérence d’un travail arrivé à maturité. Il y a une consistance de ces œuvres qui permet de les regarder longuement.
Que voyons-nous ?
Dans un entretien de 2006, à l’occasion d’une exposition, Bernard Rouseau expliquait : “Je porte une attention toute particulière sur les zones limites qu’offre la surface de l’eau, les calmes, les rapides, les berges, les radiers, les profonds, à toutes ces notions de frontières, de frange, de transparence, de flottaison, d’horizon qui sont propres à ce lieu, son rapport à un réel perçu comme fluctuant, mouvant, changeant.”
Ce ne sont pas des peintures qui “sautent au visage” ou qui éclatent de couleurs, mais qui imprègnent, comme un bain. En face de ces peintures, mon regard pénètre dans le milieu : les eaux troubles de la rivière. En face de ces portraits brouillés, de ces yeux comme des puits, au fond desquels brillent comme des lueurs, je sens l’espace inaccessible de la pensée.
Bernard Rousseau, me semble-t-il, sait peindre cette espèce de transparence, qui n’est pas la limpidité du vide cristallin, mais plutôt une traversée de différentes textures – une transparence composée d’opacité, de miroitements et de particules en suspension. Il parvient ainsi à produire ce dont la photographie se montre le plus souvent incapable, ce mirage singulier de la peinture : l’incorporation sur la toile et dans la toile d’une présence, forcément ici une épaisseur – celle de l’eau qui ne se laisse pas saisir.
La consistance de l’eau qui fuit et qui porte le regard. L’eau du regard. Ici est ailleurs.
- Sylvain Maurel, 2017.
À propos des expositions “Ailleurs est aussi ici” et “Ici est ailleurs” au Centre culturel Bellegarde et à l’Espace Saint-Cyprien, Toulouse, 2015-16.
Le temps du retard
“Les paysages que je dessine retardent, ce que vous voyez contient une double temporalité, au ici et maintenant s’ajoute ailleurs et avant ça.”
Des paysages d’eau, des visages et des mots, qui n’existent et ne sont réalité que par l’immersion qu’ils proposent dans un lieu symbole de lien, entre séparation et distance. C’est un voyage dans ce lieu profond, mouvant et inquiétant qu’est la rivière.
Pour Bernard Rousseau la pratique du dessin est intimement liée à celle de la peinture. Au-delà de toute référence de support et d’outil, le dessin est cette étape transitoire qui permet l’immédiateté. “C’est le chemin qui me mène vers…”. Vers une autre temporalité propre au pictural, qui met le visible et le réel à l’épreuve, et a le pouvoir de ralentir, d’opérer une décélération du temps. Questionner l’ambiguïté du regard, instaurer le trouble, le doute. Entre dessein et désir, cadence et rythme, endroit et envers de l’image, son œuvre semble se poser comme une frontière, une rencontre. Lorsque l’espace d’un instant, le moment où l’image qui s’efface laisse entrevoir ce qui l’a précédée, et semble alors exister par-delà du temps, dans deux espaces de réalité qui se confondent en une seule vision.
Métaphore de l’invisible, du vivant et de la mort, son travail est un moyen d’éprouver l’inabordable. “Je cherche à donner de la corporéité à l’image, à notre perception des visages et des paysages jusqu’à atteindre un point de vacillement, de tremblement, pour ouvrir un passage à travers la surface, en quête de profondeur, de mystère et de poésie.”
- Bernard Rousseau, 2011.
À propos de l’exposition “Le temps du retard” au festival “Graphéine”, Galerie Lemniscate, Toulouse, 2012.
Du temps pour peinture
Aude Payoux – J’aimerais aborder votre peinture en citant Gilles Deleuze. “Il me semble évident que l’image n’est au présent […] l’image même, c’est un ensemble de rapport de temps dont le présent ne fait que découler, soit comme commun multiple, soit comme plus petit diviseur. Les rapports de temps ne sont jamais vus dans la perception ordinaire, mais ils le sont dans l’image, dès qu’elle est créatrice. Elle rend sensibles, visibles, les rapports de temps irréductibles au présent”1.
Quelle patience exige votre peinture pour être regardée, à quelle nécessaire temporalité le spectateur est tenu pour accéder au visible, à la mémoire, à l’histoire et aux interrogations portées par les images, pour enfin se sentir au présent ?
Bernard Rousseau – Je cherche à mettre le visible à l’épreuve du temps de la peinture, à libérer l’image de sa subjectivité et de son rythme effréné, pour permettre au spectateur une appropriation et une nouvelle lecture et par la-même enfin habiter l’œuvre de l’émotion ou de la pensée qu’elle lui procure. Il y a une temporalité propre au fait pictural et j’accorde à la peinture le pouvoir de retarder, de permettre une dé-célération du temps, ou pour citer la pensée de Jean Lauxerois2 elle est “une affaire de couches et une poétique du retard” et c’est dans ce pouvoir de ralentir que je situe les enjeux de la peinture.
Expliquez-moi comment le fait pictural permet une entrée différente et différée dans l’image ? Comment se construit l’expérience de la durée dans le face à face avec votre peinture ?
La matière est mémoire du temps de la peinture, elle garde en mémoire les gestes, les opérations… dans ma peinture la première couche est un vide, un creux, une absence. Elle est l’empreinte d’une surface marquée par la chaleur d’une flamme, griffée, stigmatisée, qui laissera juste l’illusion de sa matière : la cire. Ainsi ce qui est visible à l’extrême de la surface du tableau est de l’ordre de l’invisible, juste la mémoire d’une opération, d’un geste.
Vous semblez accorder une importance toute particulière aux différents temps de construction, couches sur couches, et de lente ré-apparition de l’image. Ce qui m’intéresse, de prime abord dans votre peinture Bernard Rousseau, c’est qu’elle m’oblige à un regard vers la profondeur, qu’elle provoque ma vision et mes certitudes et qu’elle ne s’ouvre que très lentement. En pénétrant dans votre atelier, à Toulouse, je me suis sentie saisie par la noirceur de la lumière qui se dégage de chacune des peintures, ordonnant l’espace d’une certaine solennité, entre verticalité et horizontalité. Vos peintures tendent à nous impressionner, englobant notre champ de vision, obligeant notre regard à, d’une part s’élargir de plus en plus et d’autre part à ralentir. Mais revenons à ces grandes plaques de cire, posées horizontalement au milieu de votre atelier et qui servent de support à l’élaboration de vos peintures.
Elles sont même au démarrage de mon travail, elles sont la matrice de ma peinture. Je procède à l’envers de la peinture, en commençant par sa surface et en inversant la pratique conventionnelle (de l’arrière vers l’avant) d’une superposition de couches, pour finir par le fond, l’arrière de l’image. Tout commence là, face à ces plaques, dans ce rapport à une surface extrêmement sensible, parfaitement horizontale, dont la matière, la cire, pourrait paraître presque vivante, une chair. C’est cette surface que je vais d’abord “marquer” par la flamme, faire passer de l’état liquide à l’état solide, mais aussi griffer, creuser, stigmatiser. Dans ma peinture l’invention processuelle mettra à l’avant du tableau un infra sensible, à la fois présence et absence, “contact et perte de l’origine”3.
C’est à partir d’un presque “rien à voir” que la vue peut précisément s’engager à travers cette peau lumineuse sous laquelle filtre la lumière, dans cet entre-deux qui habite la peinture. Il s’agit pour moi de créer un appel par le vide, un trou d’air, une respiration à l’origine d’un mouvement, d’un souffle qui va de l’intérieur vers l’extérieur, qui nous renvoie vers la surface : vers nous-même.
Votre peinture, Bernard Rousseau, nous donne à voir, nous apprend à voir, non pas l’image, mais cette possibilité qu’a la peinture de permettre, en effet, un entre-deux, cet espace flottant, entre deux épaisseurs de matière qui est mis en suspens, en attente. Pour Philippe Sollers, “La peinture fait semblant d’être une image”, elle ouvre à un autre champ d’expériences, de sensations. Le spectateur ne s’accroche pas à une figuration ou à une narration, il réagit à une surface. C’est la raison pour laquelle j’envisage votre peinture comme un lieu de médiation : elle invite le spectateur à regarder l’intériorité de l’image, de sa représentation et de lui-même. Le spectateur n’est pas immergé dans l’immédiateté de la surface, mais aspiré par paliers, entre les différentes temporalités du pictural, mais dans la réalité même de l’œuvre. À ce titre l’arrière est une partie essentielle du tableau. Il participe à l’illusion de la perception. Une peinture où il ne s’agit plus seulement de regarder le monde, mais où nous, spectateurs sommes invités à appréhender un monde qui fortifie notre croyance en celui que nous vivons.
À ce propos, votre peinture s’organise autour de deux univers, celui des images d’actualité télévisées, notamment des grands ensembles de portraits d’hommes de pouvoir : Georges W. Bush ou Saddam Hussein, en 3 x 4 m et celui très personnel de la “rivière”. Peut-on parler du lien ou de l’articulation possible entre ces deux séries ? Elles semblent construire un monde personnel, sans véritable tension entre personnage et portrait, mais plutôt en écho, en résonance l’un avec l’autre !
Je m’imagine en arpenteur du monde, confiant à l’appareil photographique le soin d’explorer la face cachée du familier, calé dans un fauteuil, dans mon salon, ou bien de l’eau jusqu’au cou, immergé dans la rivière. Mes “familiers” devrais-je dire, ceux-là même qui me lient, m’impliquent me hantent parfois. Là encore il est question de temps et de distance mais aussi d’intime et de public. Parmi ces “familiers” il y en a un qui exerce sur moi un vrai pouvoir à la fois de reliance et de distanciation au monde – la rivière – c’est en même temps un lieu, une mémoire, un flux, une énergie, un mouvement. Rien n’y est figé.
L’immersion à laquelle convie ma peinture s’inscrit, bien sûr, aussi dans la métaphore de l’invisible que constitue ce lieu profond et inquiétant qu’est la rivière. Je porte une attention toute particulière sur les zones limites qu’offre la surface de l’eau, les calmes, les rapides, les berges, les radiers, les profonds, à toutes ces notions de frontières, de frange, de transparence, de flottaison, d’horizon qui sont propres à ce lieu, son rapport à un réel perçu comme fluctuant, mouvant, changeant.
J’ai une longue expérience de la rivière, depuis mon enfance, par la pratique notamment de la pêche à la truite, qui implique un mouvement, une immersion totale, au propre comme au figuré. Ma peinture n’ouvre pas simplement à la simple expérience du regard mais à celles de tous les sens éprouvés par ce lieu – le bruit, l’odeur, l’espace, le froid, l’air… le lieu est troublant, absorbant, captivant. La peinture est pour moi un moyen d’éprouver l’inabordable , de tenter l’expérience de l’invisible. Ce qui m’intéresse au-delà de la question posée de l’ambiguïté du regard c’est d’instaurer le trouble, le doute, le désir.
Pour citer Sigmar Polke “Le monde est pure apparence, ce n’est pas un monde signes, l’apparence n’est donc pas un signe : le signe, à la différence de l’apparence se laisse déchiffrer”.
Votre peinture interroge la notion de perception, de visibilité de l’espace intime et public à travers le paysage anonyme et la figure médiatisée, ce par quoi nous appartenons au réel, pose aussi la question de la polyphonie de l’être, chère à Julia Kristeva, et sûrement cherche ce qui nous structure, nous lie au monde.
Dans trois grandes pièces, de 3 x 4 m, vous présentez la mise en peinture du jeu des médias et de la politique, en posant ouvertement la question de la scénographie, du lieu où désormais tout se joue, du corps devenu visage, du rythme d’une rhétorique inquiétante. C’est édifiant dans “Examen médical” et “Comment allez-vous ?” (2005) où l’on voit, en douze portraits de Saddam Hussein, extraits de l’examen médical et d’une interview télévisés par les médias, suite à son arrestation et enregistrés chez vous avec un magnétoscope de salon. Et plus encore, peut-être, dans “Nous savons que Dieu a choisi son camp” (2006) où l’on reconnaît Georges Bush, dans une allocution télévisée qui justifie l’intervention américaine en Irak. En douze pièces de 1 x 1 m chacune, vous étalez et ralentissez le temps de l’image, permettant un regard plutôt subversif et donnant surtout la possibilité d’une réelle appropriation de ces images, avec notre intelligence et notre imagination et à en mesurer la dimension politique.
Nous sommes face à des images sombres, qui s’incrustent sorties de la nuit, dans notre espace intime. Elles défilent sans même prendre le temps de nous parler, des images qui bégaient notre histoire. Nous sommes face à des images qui instrumentalisent le pathos, la figure du pathos, celle du bourreau, soumis, accablé, que l’on ne différencie plus de la victime.
La plupart de ces images sont destinées à communiquer, c’est-à-dire à envoyer des messages clairs. Trop nombreuses, les images contemporaines finissent par s’annuler mutuellement, ne serait-ce que parce qu’elles entrent en effraction dans la vie du téléspectateur. Cette surabondance ne laisse pas le temps de la symbolisation. Il me semble que les images pour être efficaces, pour être actives, doivent laisser le temps d’une symbolisation, d’une appropriation, d’un écho avec l’imaginaire de celui qui les regarde. “C’est peut-être cette rapidité de la succession des images dans le monde contemporain qui les font tendre vers cette virtualité”, Jérôme Baschet4.
Les portraits de “Otages” ou de “Assassins” (2006), pourrait s’inscrire dans la même question sur le visible, le paysage photographié est une image de l’apparence, un “visage de la nature” pourrait-on dire. Le visage humain photographié lors des actualités télévisées pose doublement la question de l’image télévisuelle, on l’a vu, mais aussi individuelle, l’image de soi. La question du visage pose elle aussi celle de l’apparence et celle du rapport entre le dessus et le dessous, le devant et le derrière, et je pourrais rajouter l’avant et l’après. L’impossibilité de définir un être, mais d’abord son image semble se poser dans le vacillement identitaire, dans l’indétermination manifestée par les techniques de déplacement de l’image.
Je m’intéresse à ce qui me regarde. Faire un portrait à partir de l’image télévisée d’une personne c’est penser, par les moyens de la peinture, à partir d’une représentation soumise aux aléas du pouvoir, et se pose en préambule de toute expérience la question de la perte de l’origine (l’original), de son existence même, de la personne. Je suis dans le désir de me voir “voir” et d’expérimenter un art dont l’action est de nature contemplative et esthétique, et dont l’utilité ne relève pas du seul instrumentalisme.
Je cherche à donner de la corporéité à l’image, à notre perception de ces visages jusqu’à atteindre un point de vacillement, de tremblement, et de permettre un passage au travers de la surface, en quête de profondeur, de mystère.
- Gilles Deleuze, Le cerveau, c’est l’écran (1986), deux régimes de fous, textes et entretiens, 1975-1995, éd. D. Lapoujade, Paris, Minuit, 2003, p.270.
- Jean Lauxerois, Encore une couche (1995), dans “Où est passée la peinture ?”, Art Press spécial, 1995.
- D’après Didi Hubermann, dans “L’empreinte” (1997), éd. centre Georges Pompidou.
- J. Baschet, Concordance des temps, France culture, 15-04-2004, entretien avec Jean-Noël Jeannessey.
- Entretien avec Aude Payoux, à propos de l’exposition “Il n’y a pas de limite à l’offensive” pour L’été photographique de Lectoure, 2007.
Pas vu pas pris
C’est à partir d’une vue d’exposition et six photographies de vitrines que le MAMCO a reconstitué deux murs de l’exposition “Éloge du sujet Marcel Broodthaers” au Kunstmuseum de Bâle de 1974.
Voilà en quelques mots le début de mon interrogation sur les sphères productrices d’images, dans leurs interdépendances qui semblent parfois tourner à vide ou en rond. Il m’arrive aussi de me questionner sur le rapport à la surface qu’entretient la peinture avec le lieu et d’avoir envie de renvoyer le contexte de l’exposition à sa vacuité première.
Depuis deux années, j’ai choisi de réinvestir l’espace d’exposition et la sphère de l’art avec distance et fonctionnalité, afin d’interroger l’esthétisation des rapports présentation/représentation. “Ce que le tableau est c’est là où il est”, Marcel Duchamp, 1965-66.
On comprend que le où ne renvoie pas uniquement à une ambiance lumineuse et à une structure architecturale, mais aussi à un large contexte social et culturel qui ne va pas sans inclure les ineffables relations de personne à personne. Comme le précise Jean-Luc Godard : “Représenter c’est ajouter de la valeur symbolique au réel, c’est-à-dire légitimer le système de valeurs existant au lieu de le représenter tel qu’il est et d’agir sur lui”.
Pour cette exposition, mon travail a consisté à utiliser et à recycler dans ma peinture, des images et des textes1 issus de revues d’art spécialisées et repérées comme d’autres utilisent l’invention de la photographie, le ready-made ou encore la performance, en toute connaissance de cause en sachant que cela ne devient opérationnel qu’en tant qu’élément ludique et critique au sein d’une communication plus globale.
Je retrouve dans cette attitude une pratique de l’art qui perdure depuis le dessin de Robert Rauschenberg (Erased De Kooning) qui hante le paradigme du remake jusqu’à aujourd’hui (Douglas Gordon à la Jack Titon Gallery de New York, Bernard Basile au milieu des années 1990 ouvre une boîte à merde de Piero Manzoni, Maurizio Cattelan qui sigle des toiles fendues de Lucio Fontana par le Z de Zorro mais aussi les multiples actions, films de Pierre Huighe, Philippe Parreno, Gonzalez Foerster…). Autant d’adaptations qui gomment, recouvrent, empruntent, mettent en dérive en passant du jeu de l’espace à l’espace du jeu.
Mes “petites expositions” vont bien au-delà d’un simple jeu, elles installent le spectateur devant une mise en réseau réflexive. Elles inscrivent le visuel et l’image dans une dimension autrement circulatoire qui contrarie la présumée objectalité de l’œuvre d’art au profit d’une double fonctionnalité de l’exposition de l’œuvre et de l’œuvre exposée. Faire l’exposition me permet d’expérimenter les limites de la réitération et de mesurer celles du cadre dans lequel elle “prend place”, la galerie, l’appartement privé, le centre d’art contemporain… C’est en axant ma réflexion sur la soumission des processus de monstration à des conditions de visibilité et à une temporalité propre que j’ai mis en place une forme de résistance active qui transite par les mécanismes d’exposition et par les circuits de diffusion.
- Il s’agit pour moi de réaliser, tout d’abord, à partir d’images figurant des lieux d’expositions divers (centres d’art contemporain “régionaux”, centres d’art “nationaux”, espaces privés, galeries privées…) prélevées dans des journaux, des catalogues d’exposition, sur des cartons d’invitation, Des maquettes 3D en plâtre. C’est à partir de ce lieu représenté que j’organise la mise en scène d’une exposition, simulée par une construction en abîme de l’image – par l’emploi successif de l’aquarelle et du stylo bille, de la vidéo puis de la photographie comme autant de vecteurs d’illusions. Mes processus de réalisation évoquent les principes structurels et techniques couvrant/recouvrant de la peinture et font écho au “qu’est-ce qui ce cache dessous ?” fondateur de la mimésis picturale.
- Bernard Rousseau, 2003.
À propos de l’exposition “Pas vu pas pris” au CIAM, Galerie d’art contemporain, Université Toulouse-Jean-Jaurès, Toulouse, 2003.
Le soleil à minuit
La peinture de Bernard Rousseau se présente comme la matérialisation d’une réflexion au sens propre : deux regards se croisent et se redoublent, le regard créateur, qui est acte direct, manipulation et transformation de la matière cinématographique ; et le regard du spectateur, tout aussi actif en définitive puisque invité à recréer le sens de l’œuvre. Le regardeur est ici pris dans un dispositif qui ne lui offre pas d’échappatoire, au sens où l’espace clos lui-même, l’accrochage et finalement le “sujet” de l’image renvoie à sa propre situation de visiteur.
Le procédé plastique de manipulation et d’altération de l’image révèle une première modification : le passage du mouvement cinématographique à l’image statique de la photo. Cette mise à plat du mouvement disposée en boucle permet de le figer sans le faire disparaître. La conscience spectatorielle propre à la contemplation de la peinture réorganise, interprète et reconstruit une narration. Cependant, ce potentiel narratif n’est ici qu’un mensonge opérant : les personnages – issus d’une nouvelle altération – qui peuplent l’espace représenté renvoient à des postures vaines, sans vie et contribuent à gêner le processus d’identification. Malgré la distance imposée, c’est bien le lieu et le point de vue central du spectateur qui sont représentés. Comment comprendre ce paradoxe ? Il est en effet nécessaire à tous les stades de la réalisation puisque l’œuvre figure, au sens propre, une réflexion. En effet, chaque couche photographique et/ou picturale, produit un décalage, perceptible dans la surface exposée, entre le documentaire et la fiction. Le jeu entre ces deux termes n’est pas une alternative mais une articulation ou encore une dialectique puisque les différentes strates de manipulation sont subsumées les unes par les autres. Tout se donne à voir mais tout est caché puisque l’œuvre finale, par certains côtés esthétisants (luminosité des couleurs) et, en même temps, un aspect dégradé, mal fini, renvoie à son statut : celui de déchet, d’aboutissement secondaire d’un travail.
Bernard Rousseau poursuit donc son interrogation sur l’œuvre d’art condamnée à des utilisations superficielles et toujours décalées en réintroduisant dans l’œuvre elle-même la dérive dont elle est l’objet, ce qui permet de renouveler la question de l’œuvre comme finalité. La profondeur est définie ici comme transparence de la surface révélant les étapes de la création.
- Aude Payoux, 2001.
À propos de l’exposition “Le soleil à minuit” au BBB, Centre régional d’art contemporain, Toulouse, 2001.
Expositions personnelles en galerie :
2011-12
Galerie Lemniscate, Toulouse.
1990
Galerie Antre Dezo, Bordeaux. Galerie Diagonale, boulevard Edgard Quinet, Paris XIV.
1985
Galerie du Quai, Toulouse.
1984
Galerie Axe sud-Art actuel, Toulouse.
Expositions personnelles :
2024
“Olt ! Alt !”, Rocher de la Baume et Salle paroissiale de Calvignac, Lot.
2020
“La peinture prend l’air”, au balcon du 10 rue Boilly, Toulouse.
“Les larmes de la peinture”, Gallery Pièr Caravano, Toulouse.
2019
“J’écoute le chant du mal des roses”, Gallery Pièr Caravano, Toulouse.
2018
“Petits tracas et brêles truites”, Gallery Pièr Caravano, Toulouse.
2017
“Ailleurs est aussi ici”, Centre culturel Bellegarde, Toulouse.
“Ici est ailleurs”, Espace Saint-Cyprien, Toulouse.
2003
“Pas vu pas pris”, CIAM, Galerie d’art contemporain, UTM, Toulouse.
2001
“Le soleil à minuit”, BBB, Centre régional d’art contemporain, Toulouse.
1991
“221 B”, Palais des arts, Toulouse.
1989
“Peintures, dessins”, Centre culturel, Albi.
“Peintures”, décor pour L’opéra du pauvre de Léo Ferré, Centre culturel, Tarbes.
1988
“Peintures, dessins”, École Normale, Cahors.
Expositions collectives :
2023
“L’envers de l’endroit”, Chapelle des Cordeliers, Toulouse.
2011
Festival “Graphéine”, salon du dessin contemporain, Toulouse.
2008
Performance collaborative avec Daniel Buren, sur son œuvre Couleurs superposées, dans le cadre du Printemps de septembre, théâtre Garonne, Toulouse.
2007
“Il n’y a pas de limite à l’offensive”, L’été photographique de Lectoure, Maison Saint-Louis, Lectoure.
“Pictophotographies”, Traverse vidéo, Toulouse
2002
“Pictophotographies”, Traverse vidéo, Toulouse.
1997
“Vous êtes ici, ici ou là ?” Le Temple, avec Le Musée Khomböl, Caussade.
1996
“La vie n’est pas parfaite”, Fondation Espace Écureuil, Toulouse.
1995
“De(s) collages”, CIAM Bibliothèque universitaire du Mirail, Toulouse.
“Les Curieux”, 4 ateliers, 50 artistes, Toulouse.
1992
“Artistiques 92”, 2e Biennale des jeunes créateurs, Toulouse.
1990
“Hommage à Élie Faure”, Sainte-Foy-la-Grande, Gironde.
1989
Salon d’art contemporain, Bagneux (Hauts-de-Seine).
1985
Journées européennes des écoles d’art, Palais des arts, Toulouse.
Films et vidéos :
2016
Vidéo documentaire et entretien autour de l’exposition “Ici est ailleurs”, Centre Bellegarde.
2014
“L’invue”, écriture et réalisation. Présenté à la Galerie Lemniscate.